- Accueil >
- Browse this journal/Dans cette revue >
- 6/2016 La toile négociée/Negotiating the web >
- LA TOILE NEGOCIEE / NEGOTIATING THE WEB >
Inciter, contraindre, encadrer
Trois logiques de gouvernementalité numérique
Résumé
Le but de cet article est de donner des outils conceptuels permettant d’analyser la manière dont le pouvoir de « faire faire » s’exerce au sein des environnements numériques. Nous proposons en particulier d’avoir recours à la notion de gouvernementalité pour décrire comment certains acteurs puissants s’y prennent pour influencer les comportements d’autres acteurs qui ne sont jamais pour autant totalement impuissants. Nous décrivons trois manifestations possibles de la gouvernementalité numérique, différenciée en fonction de ce qui est « fait » par l’acteur qui « fait faire » : inciter, contraindre, encadrer. Nous donnons pour chacune un exemple précis de la manière dont le pouvoir s’exerce. Nous décrivons comment Google incite les webmasters à se conduire d’une certaine façon afin d’obtenir un bon référencement de leur site. Nous expliquons comment les développeurs de systèmes de management de contenu contraignent les pratiques d’écriture des bloggeurs. Enfin, nous montrons comment Apple encadre le processus de production des applications pour son système d’exploitation iOS (pour smarphones et tablettes). Ces trois formes de gouvernementalité numérique peuvent être heuristiques dans l’étude des phénomènes propres à Internet, dès lors qu’il s’agit d’y penser le pouvoir.
Abstract
This paper intends to propose conceptual tools for the analysis of power relationships within digital ecosystems. We suggest the use of the concept of governmentality to describe how powerful actors influence the behaviour of actors by making them act in a certain way. We describe three ways for governmentality to be exerted: encouraging, constraining, framing. For each of them, we give an example of the way power is exerted through technical resources. We explain how Google encourages webmasters to act in a certain way in order to benefit from a good ranking within the search engine’s results. Then, we explain how programmers of content management systems constrain the writing practices of bloggers. Finaly, we show how Apple frame the process of production of mobile applications for its operating system iOS.
Table des matières
Texte intégral
Introduction
1Le réseau Internet est un dispositif de communication qui articule des infrastructures et des ressources techniques, des lois et des standards, des données et des signaux, des discours et des valeurs. Internet et le web constituent des environnements autant sociaux que techniques, évoluant au gré des actions de ceux qui les conçoivent, les nourrissent et les utilisent. Ces acteurs, quels qu’ils soient, et quel que soit le niveau auquel ils se situent sur Internet (gestion des infrastructures, conception de logiciels, création de contenus ou simple navigation sur la toile) sont interdépendants. Aucun acteur ne peut agir seul, dans la mesure où la poursuite d’un projet en ligne implique inévitablement de composer avec d’autres acteurs et d’autres projets.
2Sur Internet, il n’existe pas de contrôle absolu : un acteur n’édicte de règles valables que sur son propre terrain, et ne peut pas sanctionner au-delà des frontières de ce terrain. Un hébergeur peut barrer l’accès d’une adresse IP à ses serveurs, mais il ne peut pas empêcher le flux émis et reçu par cette adresse de transiter par d’autres serveurs. Un webmaster peut protéger l’accès de son site par un mot de passe mais ne peut empêcher personne d’accéder à des sites qui ne sont pas les siens. Le propriétaire d’un moteur de recherche peut désindexer une page mais ne peut pas la supprimer. Pour résumer, chaque acteur jouit d’une liberté qui s’arrête où commence la liberté de tous les autres. Or, puisqu’un acteur a toujours besoin des autres pour agir sur Internet, et que ces autres jouissent d’une marge de manœuvres sur laquelle il n’a pas de prise, il doit les faire agir de façon à parvenir à ses fins. Comment s’y prend-il ? De quelles relations de pouvoir — et, donc, de quelle forme de pouvoir — s’agit-il ?
3Si chaque acteur jouit sur Internet d’une liberté d’action, cette liberté n’est pas la même pour tous, dans la mesure où les différents acteurs ne disposent pas des mêmes capacités à agir et à faire agir. Une start-up n’a pas le même pouvoir que Facebook, un blogueur n’a pas le même pouvoir que Google. Sur Internet, l’acteur « puissant » est celui qui réussit à relier solidement les cours d’actions autour de son projet et de ses intérêts dans un contexte où il ne peut pas se passer des autres et où il ne peut les obliger à rien. Il devra « conduire leurs conduites », c’est-à-dire s’arranger pour que certains acteurs se rendent où il le souhaite sans être en mesure de prendre le volant à leur place.
4Le but de cet article est de proposer des outils conceptuels permettant de décrire et d’analyser la manière dont le pouvoir de « faire faire » s’exerce au sein des environnements numériques. Nous proposons en particulier d’avoir recours à la notion de « gouvernementalité numérique » pour décrire comment, sur Internet, certains acteurs orientent, cadrent et contraignent les comportements d’autres acteurs. Le recours à cette notion fait référence aux travaux de Michel Foucault, selon lesquels le pouvoir est une capacité pour un individu (ou un Etat) d’influencer le comportement d’un autre individu (ou d’une population) sans avoir recours à la force (Foucault, 2004)1. Chez Foucault, l’exercice de ce pouvoir se réalise par exemple par la mise en place de politiques publiques, de réglementations, d’instruments, dont le rôle va être d’orienter les comportements des individus et des populations cherchant à réaliser une action spécifique. En ce sens, l’exercice du pouvoir révèle une dimension « encapacitante » : il s’agit moins d’interdire certaines formes d’actions que d’en autoriser d’autres, et de configurer les modalités de leur réalisation (autoriser à ce qu’une action se déroule d’une certaine manière). Si nous avons recours à ce concept, c’est justement parce que les formes de pouvoir qui s’exercent dans les environnements numériques s’accomplissent par la médiation de ressources techniques dont le rôle va être de permettre à des usagers de réaliser certaines actions, tout en leur appliquant un mode d’emploi. Dans ces environnements, « possibles » et « contraintes » sont ainsi étroitement liés.
5Dans cet article2, dont le propos s’appuie sur des études de terrain récentes (Badouard, 2012 ; Mabi, 2014 ; Sire, 2015), nous décrivons trois manifestations possibles de la gouvernementalité numérique, allant de la moins robuste, c’est-à-dire celle au sein de laquelle les gouvernés sont les plus libres, à la plus inflexible. Les cas d’étude présentés ici sont liés à des relations de pouvoir « en ligne », c’est-à-dire qu’ils concernent Internet, et plus particulièrement le web. Les modalités d’exercice du pouvoir qu’ils révèlent s’étendent pour autant au-delà du web, et peuvent potentiellement concerner toutes les formes de médiation sociale se réalisant par le biais de technologies numériques3 (d’où notre recours aux termes de « gouvernementalité numérique » et d’ « environnements numériques »). Nous avons nommé ces trois types de « faire faire » en fonction de ce qui était « fait » par celui qui « fait faire » : inciter, contraindre, encadrer. Nous définirons ci-après chacune de ces formes de gouvernementalité en donnant à chaque fois un exemple précis de la manière dont le pouvoir s’exerce et de la façon dont il peut être décrit grâce à l’outil conceptuel que nous proposons. Nous verrons comment Google peut inciter les webmasters à se conduire d’une certaine façon afin d’obtenir un bon référencement de leur site. Nous verrons comment les développeurs de systèmes de management de contenu peuvent contraindre les pratiques d’écriture des bloggeurs. Enfin, nous verrons comment Apple réussit à encadrer le processus de production des applications pour son système d’exploitation iOS (pour smarphones et tablettes). En conclusion, nous expliquerons en quoi nous pensons que ces trois exercices de gouvernementalité numérique peuvent être heuristiques dans l’étude des phénomènes propres à Internet, dès lors qu’il s’agit d’y penser le pouvoir.
1. Inciter les conduites
6La première forme de gouvernementalité que nous proposons de définir s’exerce par « incitations ». Ce terme — du latin incitare : pousser, exciter, stimuler — a largement été utilisé en économie pour désigner l’instrument grâce auquel on cherche à conduire un acteur à agir d’une façon qui a priori n’est pas dans son intérêt : il désigne par exemple une mesure fiscale destinée à récompenser les entreprises réduisant leurs émissions de gaz carbonique. L’économie politique désigne sous ce vocable « toute mesure spécifique (…) non obligatoire, cherchant à obtenir des agents qu'elle vise, un comportement déterminé, non souhaité par eux, ou qu'ils n'ont pas idée d'adopter au moins au départ en échange d'un ou plusieurs avantages déterminés » (Quiers‑Valette, 1978). Il s’agit bien d’un mécanisme « d’incitation-régulation des phénomènes » (Foucault, 2004, p. 361), utilisé pour conduire la conduite d’acteurs qu’on ne force à rien : « la liberté se fait instrument de gouvernement. » (Cohen, 2011, p. 73). L’économie industrielle a forgé, à partir de la théorie des jeux, une théorie des incitations. Comme l’explique Jean-Jacques Laffont, « [l]a question la plus élémentaire de la théorie des incitations consiste pour le [joueur] principal à choisir des règles de jeu que l’autre joueur, l’agent, doit accepter […] et qui maximisent l’espérance d’utilité (du [joueur] principal) étant donné le comportement stratégique de l’agent » (Laffont, 2006, p. 178).
7Nous proposons quant à nous de donner une définition communicationnelle à l’incitation, pour décrire la manière dont, dans les environnements numériques, les actions sont orientées. Sur Internet, on incite (éventuellement) les autres et l’on est soit même (forcément) soumis à des incitations. Nous pensons dès lors qu’il est bénéfique pour le chercheur intéressé par un phénomène propre au réseau de cartographier les incitations auxquels sont soumis les acteurs, ce qui lui permettra dans un second temps de mieux comprendre les schèmes d’action et les tenants du pouvoir qu’il est possible d’exercer théoriquement, pour finalement, dans un troisième temps, observer le pouvoir exercé effectivement et les effets concrets de ce pouvoir en termes d’information et de communication.
8Une incitation est avant tout constituée de deux éléments : une information et une interprétation. Elle est indissociable, en tant qu’énoncé, des perceptions de celui qui est incité. L’acteur qui incite (le locuteur) prend en compte les souhaits de celui qu’il cherche à inciter (l’allocutaire) pour traduire l’ordre qu’il souhaite lui donner (l’énoncé) en le transportant et en le transformant autant de fois qu’il sera nécessaire (Latour et al., 1991). L’acteur incité reçoit alors des signaux dont l’interprétation le conduit à estimer qu’il serait intéressant pour lui d’agir d’une façon non souhaitée, ou tout du moins non envisagée, au départ. Tant qu’elle n’est pas éprouvée, l’incitation ne peut donc être qu’hypothétique : celui qui a émis le signal ne peut qu’espérer qu’il devienne effectivement une incitation au contact des allocutaires. D’autre part, les signaux peuvent être interprétés différemment de ce qui a été prévu par le locuteur et devenir pour l’allocutaire des incitations à faire tout autre chose que ce qu’espérait le locuteur. Notons également qu’une incitation, même si elle incite, ne provoque pas forcément : les acteurs peuvent décider de ne pas y obéir, soit parce qu’elle n’est pas assez incitative en tant que telle, soit parce que l’acteur incité n’a pas les moyens d’agir dans le sens de l’incitation, soit encore parce que d’autres incitations sont plus fortes.
9Une incitation peut être matérielle, fiscale, financière, morale. Elle est médiée par l’agencement du discours, de la technique, des valeurs et des intérêts. Elle est toujours le fruit d’une prévision de la part d’un acteur quant à ce qu’il pourra retirer de telle ou telle action. C’est une force qui encourage à procéder à une action (ou à une non-action) censée provoquer des bénéfices. En ce sens, l’incitation est faite de « vouloir », de « savoir » et de « pouvoir » : elle est la somme de ce que je veux faire, étant donné ce que je peux avoir, et de ce que je veux avoir, étant donné ce que je sais faire. Il en résulte une forme d’exercice de la gouvernementalité basé à la fois sur les capacités d’action des acteurs et sur leurs capacités de calcul et de prévision. Nous verrons toutefois qu’une incitation peut susciter l’action sans que l’acteur incité ne se voie attribuer la récompense qu’il espérait obtenir en agissant.
10Afin d’illustrer cette gouvernementalité par incitations, nous donnerons l’exemple du pouvoir exercé sur le web par Google vis-à-vis des éditeurs de sites web. La firme Google propose, parmi d’autres services, un moteur de recherche qui classe les sites présents sur le web en fonction de leur popularité. Plus un contenu est pointé, via des liens hypertextes, par d’autres sites, et plus il est considéré par le moteur de recherche comme populaire. S’ajoutent à cela d’autres critères, pris en compte par l’algorithme du moteur de recherche, comme l’audience (le nombre de visiteurs qui consultent le contenu). Ainsi, quand un internaute effectue une requête via Google, le moteur de recherche recense l’ensemble des contenus qui abordent le sujet de la requête, puis les classe en fonction de leur popularité, les plus visités et ceux bénéficiant du plus grand nombre de liens arrivant en première position.
11Pour que le moteur de recherche fonctionne au plus près de ce qui est souhaité par ses concepteurs, il faut idéalement que les éditeurs de sites se conforment à un certain nombre de règles concernant la structure de leurs sites, les formats des documents, le texte, les métadonnées et l’usage des hyperliens. En effet, le moteur de Google « scanne » les sites selon une procédure prédéfinie (pour le dire vite, du « haut » vers le « bas »), et en prenant en compte différents critères, comme l’adresse URL, le titre des articles présents sur la page, l’organisation des textes, les légendes des illustrations, etc. Par exemple, un format Flash est considérablement moins facile à indexer pour Google qu’un format HTML. Une adresse URL et un titre explicites, ainsi que des mots-clés figurant tôt dans le texte, aident à l’inverse le moteur à indexer correctement le contenu. L’usage du lien hypertexte consistant à pointer vers un contenu pertinent et à ancrer le lien sur un groupe de mots décrivant explicitement le contenu pointé aide Google à juger de sa pertinence.
12Un grand nombre d’actions peuvent ainsi être effectuées par l’éditeur pour simplifier la tâche du moteur et agir dans l’intérêt de son propriétaire, sans que cela soit a priori bénéfique pour l’éditeur et sans que les employés de Google puissent le faire à sa place. La firme propriétaire du moteur n’a par conséquent pas d’autre choix que d’inciter les éditeurs à mettre en œuvre ces actions. Pour cela, ses porte-parole font entendre que la mise en œuvre des actions recommandées par la firme (sur son Centre d’aide aux webmasters, ses blogs, ses forums et dans le « guide du Search Engine Optimization ») pourra améliorer le référencement des contenus et permettre aux sites de recevoir un trafic substantiel. Google n’est cependant pas en mesure de garantir le résultat des actions d’optimisation, car en effet, si la firme garantissait une récompense à chaque éditeur mettant en œuvre ses recommandations, elle ne serait plus en mesure d’établir un classement hiérarchique parmi les contenus des éditeurs qui auraient scrupuleusement respecté ses consignes. Une incitation peut ainsi s’appuyer sur un espoir d’obtenir une récompense et non pas toujours sur une garantie d’obtenir cette récompense. Parce que Google est en position dominante sur le web, et étant donné le trafic que son moteur est susceptible d’apporter aux éditeurs, la firme réussit à fortifier une « norme de publication » en dirigeant les actions d’acteurs qu’elle ne peut forcer à rien (Röhle, 2009).
13Comme l’explique Theo Röhle, l’utilisation par l’éditeur des Outils pour les Webmasters proposés par Google constitue un moyen « d’établir une chaîne de communication entre Google et les webmasters. (…) Les webmasters sont encouragés à adapter leur contenu d’une manière avantageuse pour Google. De plus, les webmasters sont invités à indiquer les sites qui ne respectent pas les règles définies par Google » (ibid.). Ainsi, en plus de les inciter à agir d’une façon avantageuse pour Google, la firme incite les éditeurs à se surveiller les uns les autres et à dénoncer ceux qui n’agissent pas de cette façon. Theo Röhle y voit un « régime disciplinaire » au sein duquel il est régulièrement rappelé aux éditeurs les récompenses qu’ils obtiendront peut-être s’ils se conforment aux recommandations de Google, et le déclassement qui se produira s’ils ne le font pas. C’est cette forme d’exercice du pouvoir, que nous retrouvons dans de nombreuses situations au sein des environnements numériques étant donné l’impossibilité des acteurs d’imposer par la force un cours d’action à d’autres acteurs, que nous nommons « gouvernementalité par incitations ».
14L’exemple de Google illustre également la manière dont certaines incitations peuvent émerger de l’agencement sociotechnique lui-même et non directement de la volonté d’un acteur, et contrer les signaux dont les locuteurs voudraient que les allocutaires les interprètent comme autant d’incitations. Etant donné le fonctionnement de l’algorithme PageRank, qui fait de chaque lien vers une page un indicateur positif quant à la pertinence du contenu de cette page (Brin et Page, 1998 ; Rieder, 2012 ; Cardon, 2013), les éditeurs peuvent être incités à n’effectuer des liens que vers leurs propres pages, et jamais vers l’extérieur. Or, cet « égocentrisme hypertexte » va dans le sens inverse des incitations émises par Google et menace ce que les concepteurs du dispositif considèrent comme étant le fonctionnement optimal du moteur. Les ingénieurs de Google agissent par conséquent pour contrebalancer ces incitations, en annonçant par exemple que les liens effectués par un éditeur vers lui-même seront moins porteurs d’autorité que les liens provenant de l’extérieur. La firme communique également sur son Centre d’aide aux webmasters que la pertinence des liens effectués vers l’extérieur sera récompensée4, et demande aux éditeurs de ne pas participer à des « systèmes de liens », de ne pas faire de liens factices destinés à « tromper Google » et de limiter le nombre de liens par page, tout en les invitant à se poser constamment la question suivante : « Aurions-nous fait appel à ces techniques si les moteurs de recherche n'existaient pas ? »5.
15Si on considère que le moteur de recherche Google ne peut plus fonctionner sans le PageRank, il est intéressant de noter que les éditeurs, individuellement incités à pointer vers leurs propres contenus, sont en même temps incités à effectuer des liens vers l’extérieur, car si aucun d’eux ne le faisait, le PageRank serait inopérant. Considéré comme un ensemble homogène, les éditeurs sont donc incités à faire des liens vers l’extérieur, le risque étant qu’un éditeur se désolidarise du groupe et agisse dans son seul intérêt. Il fera alors ce que ses homologues ne doivent pas faire afin, précisément, que cette action puisse lui être bénéfique. Son action n’aura ainsi l’effet escompté que si les autres agissent de manière inverse. Ainsi, les incitations d’un groupe d’acteurs peuvent être contraires aux incitations individuelles de ces mêmes acteurs. Il en découle une forme d’éthique dans le sens où le principe qui prévaut à ce type d’action ne peut pas être généralisé et où ce type d’action, donc, ne rencontre pas l’impératif catégorique kantien (Sire, 2016).
16Au final, Google parvient à promouvoir une norme de publication, mais l’exercice de son pouvoir rencontre des résistances visant au mieux pour la firme à ignorer ses recommandations et au pire à tromper le moteur pour attirer du trafic, ce qui oblige Google à constamment re-paramétrer son algorithme et à communiquer pour continuer à inciter les éditeurs à agir dans le sens de ses intérêts, de son projet, de sa vision. « [C]haque effet positif ou négatif, voulu ou non voulu, vient entrer en résonance, ou en contradiction, avec les autres, et appelle à une reprise, à un réajustement, des éléments hétérogènes » (Foucault, 1994, vol. 3, p. 299). Les incitations s’ajoutent les unes aux autres, se contredisent, se contrefont, s’annulent et s’amplifient, tandis qu’un aller-retour se crée entre les dynamiques incitatives et les réseaux d’actions, les causes et les effets, le signal et l’interprétation, le locuteur et l’allocutaire, les projets et leurs résultats.
2. Contraindre les conduites
17Le deuxième type de gouvernementalité que nous proposons d’identifier est basé sur la contrainte. Dans un environnement numérique, contraindre un comportement revient à paramétrer une possibilité d’action : pour qu’une technologie contraigne un comportement, elle doit le rendre possible puis lui appliquer un mode opératoire, pour que l’action se réalise d’une certaine façon. La contrainte ne doit donc pas être perçue comme un interdit mais comme une canalisation, une proposition normative de définition de l’action. L’exercice du pouvoir se joue dans la manière de concevoir l’outil par lequel l’action advient : un concepteur de logiciel par exemple exerce un pouvoir à travers le paramétrage du logiciel, qui détermine en partie la forme que pourra prendre, idéalement, l’action de l’usager qui se saisit du logiciel. Nous n’écrivons pas de la même manière selon que nous utilisons un logiciel de traitement de texte, un logiciel de présentation ou un tableur, tout simplement parce que les modalités d’écriture qui nous sont offertes sont paramétrées de manières différentes. De la même façon, il n’est pas possible de produire des messages de plus de 140 caractères sur Twitter, ou de ré-agencer l’ordre des commentaires d’un statut Facebook. Ces limites imposées à nos actions le sont parce que les technologies que nous utilisons ont été conçues selon un projet d’usage établi par leurs concepteurs6. Les possibilités de débordement ou de détournement de ces technologies existent bien sûr, mais dès lors que nous les utilisons en respectant ce projet d’usage, nous rendons nos comportements conformes aux attentes des concepteurs, qui exercent ainsi une forme de pouvoir sur le cours de nos actions. Contrairement à la gouvernementalité par incitations, qui ne diminue en rien la liberté des gouvernés, contraindre l’action revient à diminuer leur liberté en restreignant l’étendue des possibles. On n’oriente pas tant l’action qu’on la localise, la contingente, la modère, la contient. Alors qu’un individu incité peut décider d’ignorer les incitations, ou qu’il peut ne pas percevoir les signaux émis comme autant d’incitations, l’individu contraint, lui, ne peut pas ignorer les contraintes. Celles-ci, à l’inverse des incitations, ne dépendent pas de son interprétation. Ce sont des règles du jeu fixées indépendamment du joueur et a priori de son action, si bien que celui-ci n’aura pas d’autre choix que de composer avec elles ou de quitter le jeu définitivement.
18Cette manifestation de la gouvernementalité n’est pas propre au numérique, et relève davantage d’une relation de délégation que nous entretenons avec les objets techniques (Simondon, 1958 ; Latour, 1999). Nous déléguons en effet aux objets qui nous entourent des fonctions, qui se réalisent par les contraintes qu’ils imposent à nos comportements. Prenons l’exemple du « gendarme couché », ou « dos d’âne », cher à la sociologie de la traduction (Latour, 1999). L’injonction « ralentir » est déléguée à un bourrelet de béton obligeant les automobilistes à lever le pied de l’accélérateur. C’est la matérialisation d’une prescription morale à ne pas commettre d'excès de vitesse. Le gendarme couché agit comme une contrainte : l’automobiliste ne peut l’ignorer, il ne dépend pas de son interprétation (contrairement à un panneau qui indiquerait que des enfants sont susceptibles de traverser la route, dans l’espoir d’inciter l’automobiliste à ralentir, et qui pourrait peut-être avoir le même effet mais qui ne relèverait plus du même type de gouvernementalité). Le niveau de contrainte que le dos d’âne exerce à l’égard du conducteur dépend à la fois de sa forme et de son emplacement, ainsi que du modèle de voiture du conducteur et de ses compétences. Ce dernier saura peut-être comment il est possible de ralentir le moins possible sans détruire son véhicule, ou comment emprunter une autre voie qui lui permettra de maintenir sa vitesse sans rencontrer le gendarme couché. La contrainte dépendra finalement de celui qui la met en place, de la technique qu’il utilise, ainsi que des outils et des compétences de celui sur lequel elle est censée s’exercer.
19Les environnements numériques sont pavés de contraintes. A un premier niveau, le code informatique contraint les acteurs à s’exprimer d’une façon qui ne peut pas être approximative et qui limite le champ des possibles : « Les contraintes imposées par le fait que tout langage de programmation est un langage formel qui ne permet pas de formulations ambiguës et n’accepte qu’une syntaxe parfaite, impliquent que le nombre de solutions à un problème spécifique est fini » (Rieder, 2006, p. 243). En découle une certaine logique binaire du numérique, on l’acte de codage revient à programmer des choix (Rushkoff, 2010). A l’échelle de la programmation justement, les concepteurs de logiciels, d’applications ou de sites, disposent de différentes ressources qu’ils agencent pour rendre opérationnel un projet d’usage. Aux applications qui permettent d’agir sur les contenus (production, modification, personnalisation, filtrage, évaluation) et à celles qui permettent d’interagir (forums, commentaires, « poke ») s’ajoutent l’organisation des rubriques (l’arborescence des sites) qui oriente vers certains types de contenus. Le design des sites web donne donc à voir les projets stratégiques, et attribue des rôles et des ressources aux internautes (Wright, Street, 2007 ; Monnoyer-Smith, 2010 ; Badouard, 2014). Ces projets sont rendus opératoires, et ces rôles sont remplis, grâce à aux contraintes régulant les actions des usagers.
20Pour illustrer cette manifestation de la gouvernementalité, prenons l’exemple des systèmes de management de contenus (CMS) utilisés pour publier de l’information, aussi bien par les amateurs que par certains professionnels. Les CMS permettent de publier des informations en langage naturel, sans passer par un quelconque langage de programmation. Fer de lance du web dit « 2.0 », les CMS ont permis à toute une génération d’internautes non-programmeurs de produire des sites et des blogs (Cardon et al., 2006). Ils se présentent sous la forme d’interfaces intuitives dont on remplit les cases, comme pour un formulaire, avant de cliquer sur la commande « publier ». Il en va ainsi, par exemple, des logiciels Spip ou Wordpress, qui permettent de créer des sites et des blogs sans connaissance particulière du code informatique.
21Les CMS restreignent le champ des possibles du code HTML : dans le but de simplifier la tâche de l’éditeur, ils proposent de limiter le nombre d’actions qu’il peut faire. Ils fortifient une norme de publication sur le web : « les sites ont souvent un « air de famille, à partir du moment où leurs créateurs ont employé un même CMS pour les établir et ce, quand bien même les objectifs de communication de chacun sont largement divergents » (Jeanne-Perrier, 2005, p. 71-72). Ainsi, il est facile, pour un œil averti, de reconnaître des sites qui ont été conçus sous Wordpress, tout simplement parce que les mêmes contraintes d’écriture s’appliquent à tous ses utilisateurs. Dans la partie privée d’un Wordpress, les mêmes possibilités de production et de mise en forme des écrits sont proposées aux utilisateurs, les mêmes systèmes d’organisation des rubriques, les mêmes outils de filtrage des contenus.
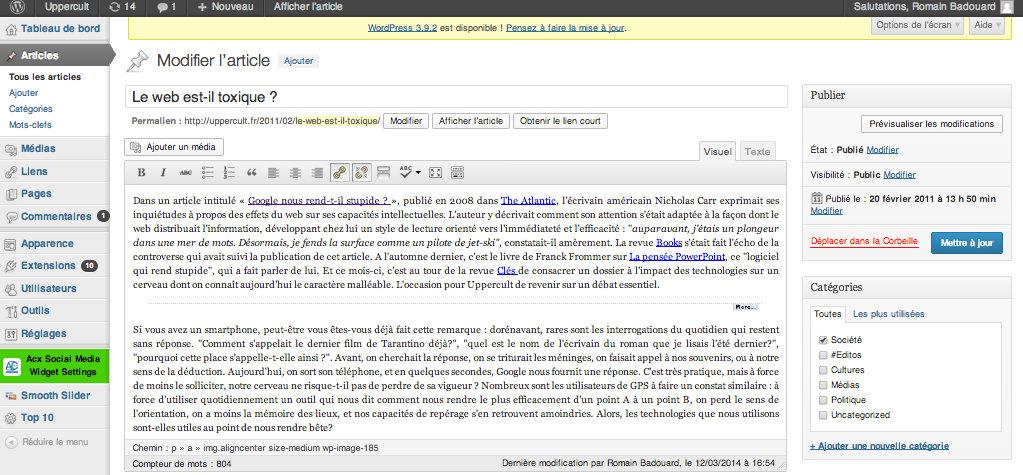
Interface de la partie privée d’un site Wordpress
22Valérie Jeanne-Perrier s’est intéressée aux CMS et à la contrainte à laquelle les auteurs sont soumis, en montrant notamment pourquoi « au-delà de la simple question de la facilité de la publication, ce sont les possibilités de contrôle sur les écrits à venir à partir du CMS qui sont concernées » (ibid., p. 77). Certains auteurs, à condition d’avoir les compétences nécessaires, peuvent réécrire certaines lignes de codes du CMS pour se l’approprier. Ils effectuent alors des allers-retours entre l’interface intuitive et le langage de programmation, pour in fine se construire un outil de publication sur mesure grâce auquel leur site ne ressemblera pas, ou moins, aux autres sites. Ils développent alors un « art opératoire » (Flichy, 2003) : même s’ils se déplacent dans un champ qui les régule à un premier niveau, « ils y introduisent une façon d’en tirer parti qui obéit à d’autres règles et qui constitue comme un second niveau imbriqué dans le premier » (De Certeau, 1980).
23Dans ce cas, il y a subjectivation (« instrumentation par l’instrumenté »), et le pouvoir change de camp. Le concepteur du CMS n’exercera plus, ou moins, la conduite des conduites qu’il avait prévu d’exercer. L’auteur agira en tant que « façonnier », selon les termes de Valérie Jeanne-Perrier, à condition d’en avoir les compétences, ce qui « demande un investissement et un approfondissement, éloignant l'outil d'une simplicité de prise en main et de manipulation. » (op. cit., p. 75). Une telle prise en main, explique Valérie Jeanne-Perrier, peut d’ailleurs être souhaitée par les concepteurs de CMS eux-mêmes, qui voient d’un bon œil le fait que les auteurs deviennent « co-éditeurs » en s’appropriant leurs interfaces et qu’une partie du contrôle qu’ils pourraient exercer leur échappe. C’est le cas par exemple du CMS Spip dont les créateurs « défendent l'idée que leur solution permet, même à un amateur, d'apposer sa marque sur l'aspect de son site » (ibid.).
24Finalement, que nous nommons « gouvernementalité par contraintes » est caractérisé par une certaine plasticité des dites contraintes, qui dépendent à la fois du projet de celui qui tente d’exercer son pouvoir, des instruments utilisés, des compétences des gouvernés et des outils qu’ils ont à leur disposition.
3. Encadrer les conduites
25Le troisième type de gouvernementalité numérique que nous souhaitons aborder ici est le plus « robuste » de tous : il s’agit de fixer des cadres d’action indépassables en définissant les paramètres de fonctionnement d’un environnement numérique dans sa globalité. Contrairement à la gouvernementalité par contrainte, qui passe par la manipulation d’outils pour produire un ajustement des comportements (et induit donc, comme nous l’avons souligné dans la partie précédente, une certaine flexibilité), la gouvernementalité par cadrage vise à définir des normes d’action indépendantes des compétences ou de l’équipement de ceux dont les conduites sont encadrées.
26Pour filer la métaphore du monde automobile, nous pourrions par exemple comparer la gouvernementalité par incitation à ce qui a trait au code de la route et aux panneaux de signalisation : les automobilistes sont incités à adopter un certain comportement via un dispositif qui articule des formes d’intéressement (protéger son intégrité physique et celle des autres) et de sanctions (amendes et retraits de permis). La relation de pouvoir se joue dans l’interprétation que le conducteur fait de ces signes, à partir de laquelle il va ajuster (ou non) son comportement. La gouvernementalité par contrainte correspondrait quant à elle aux caractéristiques techniques du véhicule utilisé : selon sa puissance, son équipement ou sa taille, le chauffeur adoptera différents styles de conduite. Ici, la relation de pouvoir se joue dans la configuration (du côté du constructeur) et dans la manipulation (du côté du chauffeur) du véhicule. La gouvernementalité par cadrage correspondrait alors aux infrastructures routières : les automobilistes sont « obligés » de suivre le tracé d’une route pour se rendre d’une ville à une autre, et ne peuvent pas conduire « hors des routes », c’est-à-dire hors des espaces praticables produits à cet effet. La relation de pouvoir se joue dans la définition des possibles (le tracé des infrastructures) et dans l’identification de régimes d’action qui seront proposés aux usagers au sein d’un environnement technique particulier.
27Tandis que l’incitation et la contrainte peuvent émerger sans avoir été préméditées, le cadre est nécessairement le fruit d’une action volontaire. Les autres acteurs n’ont pas d’autre possibilité que de se déplacer sur un terrain dont les limites ont été fixées sans leur concours et de jouer à un jeu dont les règles ne sont pas négociables. Les systèmes d’exploitation constituent une bonne illustration de ce type de gouvernementalité numérique. Un système d’exploitation n’est pas un logiciel que l’on manipule, mais un environnement qui règle la manière dont un usager interagit avec un logiciel et consulte des contenus, via une interface qui apparaît sur l’écran d’un terminal. Windows 8, Mac OS X ou encore Ubuntu (Linux) sont des systèmes d’exploitation. Ils fixent les modalités d’action et d’interaction au sein de ces environnements : sur Windows, sur Mac ou sur Linux, un usager disposera de différentes possibilités de consultation et de manipulation des fichiers et des programmes, même si ces trois systèmes d’exploitation reposent sur des interfaces similaires (Thierry, 2013).
28En 2007, le lancement par Apple de l’iPhone s’est accompagné d’un nouveau type de système d’exploitation, iOS (pour iPhone Operating System), qui s’affranchit de la souris (remplacée par les doigts de la main par le biais d’une interface tactile) et de la fenêtre (via des applications mobiles). On retrouve le même type de système avec Androïd, développé sur Linux puis racheté par Google en 2005. Le lancement de ces systèmes d’exploitation d’un nouveau genre induit de nouveaux cadres d’action pour l’usager, qui ne sont pas exempts de la promotion de certains principes et de certaines valeurs. Leur émergence a ainsi pu être interprétée comme le signe d’une fermeture du web et d’une re-concentration du pouvoir aux mains d’acteurs privés (Zittrain, 2008 ; Benkler, 2016), voir même de la mort pure et simple du « web ouvert »7.
29La principale particularité d’un système d’exploitation comme iOS est d’organiser une segmentation généralisée des capacités d’action des usagers. Comme le précise Apple sur son site, les applications sont conçues « comme des îles » : indépendantes, isolées, sans passerelles permettant de les faire interagir. L’image plus couramment utilisée pour décrire les applications est celle de jardins murés (walled gardens) : elles cohabitent dans un même espace sans communiquer, en proposant chacune un service particulier et en empêchant des personnes tiers de venir y publier. Les informations ne circulent pas d’une application à une autre, ce qui signifie que les capacités d’action offertes par une application ne sont pas ré-exploitables par une autre application. En d’autres termes, au sein de ces systèmes d’exploitation, la capacité d’agir n’est pas cumulable.
30L’environnement y est extrêmement fonctionnalisé : à chaque application sa fonction, à chaque fonction son application. Les systèmes d’exploitation pour terminaux mobiles reposant sur des applications impliquent donc un régime d’action morcelé, où chaque activité quotidienne peut être identifiée, isolée, circonscrite, afin d’y attacher un outil spécifique d’assistance numérique. Plus ces activités peuvent être isolées les unes des autres, plus le niveau de granularité est fin, et plus on peut y faire correspondre un besoin, et donc vendre ou proposer une application dédiée.
31Pour mieux comprendre les nouveaux cadres d’action qu’impliquent ces systèmes d’exploitation, intéressons-nous à la procédure par laquelle Apple encadre le travail des développeurs d’applications. Si iOS est conçu par Apple, les applications disponibles pour l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch sont dans leur très grande majorité développées par des designers indépendants (il existe aujourd’hui plus d’un million d’applications disponibles pour iOS). Or, pour conserver la main sur ce qu’un appareil mobile doit permettre ou ne doit pas permettre de faire, Apple a créé une procédure d’enrôlement extrêmement contraignante, qui englobe toute la chaîne de production des applications, depuis les débuts de leur programmation jusqu’à leur mise en vente sur l’App Store.
32Tout d’abord, si un développeur veut développer et proposer une application sur l’App Store, il doit souscrire au Mac Developper Program, qui lui permet d’avoir accès à une documentation fournie sur le développement des applications, à des forums d’entraide, et de pouvoir soumettre son application à évaluation. La souscription coûte 99$ par an. Ensuite, pour développer son application, il devra se conformer à un certain nombre d’exigences contenu dans le guide de développement officiel de la marque : l’iOS Developper Library. Les « recommandations » concernent à la fois le graphisme de l’application, son design, ses fonctions.
33Apple précise qu’une application doit articuler quatre éléments : une barre de navigation, située en haut ou en bas de l’écran, qui contient des informations contextuelles et permet à l’utilisateur de se repérer et de se déplacer dans l’application ; des modalités de visualisation des contenus (« content views »), qui doivent « autoriser certains comportements », comme le scrolling, l’insertion d’informations, la suppression et le ré-agencement des items ; les barres de contrôle, qui permettent de sélectionner parmi les informations disponibles ; des vues temporaires, qui s’affichent pour donner une information ponctuelle (le « push »). A travers ces exigences, Apple dessine une représentation de l’usager-type, tourné vers la consultation de contenus. L’usager est perçu comme un consommateur actif d’informations, qui peut la trier, la consulter, la supprimer, mais pas comme un producteur. La production de contenu doit en effet se faire sur le modèle de l’ « insertion », c’est-à-dire le remplissage de cases laissées vides dans un formulaire.
34Surtout, Apple précise explicitement que les usagers doivent, dans la limite du possible, ne pas avoir à insérer du contenu : les développeurs doivent davantage proposer des listes de choix (par exemple pour choisir un pays ou une date, il est préférable pour l’usager, selon Apple, de choisir au sein d’une liste plutôt que de taper directement du contenu). Autrement dit, le système d’exploitation iOS induit une logique d’action qui repose sur la consultation et le choix pré-programmé (les possibilités d’action d’un usager doivent être identifiées a priori et inscrites dans l’application), davantage que sur la production et la mise en circulation de contenus. La manière dont une application doit permettre et contraindre les activités des utilisateurs est également détaillée. Ces possibilités doivent être limitées et explicites, afin de favoriser un usage intuitif. Les modalités d’action doivent être « simples, courtes, étroitement ciblées », et se rapporter à un nombre restreint de registres qui ont trait aux interactions tactiles avec l’interface : ouvrir, fermer, zoomer, valider, déplacer ou sélectionner.
35Apple précise que cette exigence de simplification des registres d’action est en partie due à la taille réduite des écrans des smartphones et des tablettes, et que les possibilités d’action ponctuelles ou occasionnelles sur les contenus doivent être mises de côté. Apple propose au téléchargement un ensemble de boutons à insérer dans les barres d’action, afin de faciliter cette pré-programmation des registres d’action. Enfin, il est également demandé aux développeurs de réduire les possibilités de paramétrage de leurs applications, et d’utiliser les données d’usage directement contenues dans le téléphone des usagers pour les paramétrer automatiquement. Autrement dit, au sein d’environnements comme iOS, les capacités d’action des usagers sont fortement réduites, en comparaison des systèmes d’exploitation pour ordinateurs : elles sont limitées en nombre, identifiées a priori et doivent le moins possible être paramétrables, c’est-à-dire adaptables aux stratégies et aux besoins des usagers.
36Une fois qu’une application est produite selon les exigences de la marque, son développeur doit la soumettre à un processus d’évaluation : un autre développeur rémunéré la teste pour évaluer sa compatibilité avec le guide de développement d’Apple. Le App Store Review Guidelines est un document mis à la disposition des développeurs, qui décrit les différents motifs pour lesquels une application peut être refusée. Ces motifs sont au nombre de 141, et concernent à la fois le contenu (pas de pornographie pas exemple), le programme en lui-même (l’application ne doit pas lancer de script de manière autonome), l’utilisation des données personnelles des utilisateurs ou encore la fonction même de l’application (qui doit être « originale » et apporter « une plus-value »). Si un élément ne convient pas à l’évaluateur, le développeur doit modifier son application. Une fois celle-ci validée, elle est proposée sur l’App Store, le point d’entrée unique pour télécharger des applications pour iOS. Si celle-ci est payante, Apple prélève 30% du prix de vente de l’application. En 2013, l’App Store a généré un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars.
37La gouvernementalité par cadrage revient donc à produire un environnement numérique et ses normes de fonctionnement : les outils qui seront proposés aux usagers devront respecter ces normes. Dans notre cas d’étude, les régimes d’action sont identifiés a priori et inscrits à la fois dans le design du système d’exploitation et dans la configuration d’une procédure particulièrement verrouillée, qui permet au producteur de garder la main sur le développement du système d’exploitation. Les règles du jeu sont définies et imposent une certaine conception des possibles, qui reste indépassable sans « sortir du jeu ». Il s’agit en quelque sorte de développer un socle immuable à partir duquel les possibilités d’action qui vont être développées à destination des usagers seront définies. Apple décide ainsi ce qui peut avoir lieu et fixe les limites de cet « avoir lieu ».
Conclusion
38Nous avons défini dans cet article trois façons de « conduire les conduites » dans les environnements numériques, et plus particulièrement sur Internet : l’incitation, la contrainte et le cadre. L’incitation est ce qui tire : le gouvernant suggère au gouverné l’adoption d’un certain comportement par un système d’intéressement/sanction. La contrainte est ce qui limite : le gouvernant oriente le comportement du gouverné en paramétrant l’outil par lequel l’action est réalisée. Le cadre est ce qui fige : le gouvernant fixe un catalogue de registres d’action qui seront mis à disposition du gouverné, délimitant ainsi un horizon des possibles au sein d’un environnement numérique particulier. Ces formes de « conduite des conduites » correspondent à des relations de pouvoir entre individus, ou entre groupes d’individus, qui se réalisent par le biais de ressources techniques, comme des algorithmes, des systèmes de management de contenus ou des systèmes d’exploitation. Les ressources à disposition des gouvernants pour « imposer » un type de gouvernementalité n’appartiennent cependant pas uniquement au registre technique, et s’articulent notamment à des stratégies économiques (rachats de concurrent par exemple) et des dispositions juridiques (lois anti-trust). Ce que nous avons cherché à faire ici, c’est plus précisément de décrire la manière dont s’exerce un pouvoir sur les cours d’action des individus dans un environnement numérique (le comment), plutôt que d’analyser les stratégies qui commandent à cet exercice (le pourquoi).
39Afin d’appréhender concrètement ces mécanismes, nous avons expliqué pourquoi il convenait de considérer la matérialité des relations de pouvoir sur Internet, en questionnant la manière dont ces relations se concrétisent techniquement, par la médiation des dispositifs, et viennent influer sur les possibilités de subjectivation. Nous avons montré que si le pouvoir peut être considéré comme diffus dans un nombre infini de relations, il n’en passe pas moins par des points de contrôle dont il est nécessaire de sonder la matérialité pour comprendre les rapports de force en jeu. Ainsi, le recours au concept de « gouvernementalité » pour décrire l’exercice du pouvoir dans des environnements numériques nous a permis de montrer comment, sur internet, les possibles ne vont pas sans contraintes, et comment les intentions de communication y sont « balisées », d’une part par les possibilités propres au code, aux logiciels, aux infrastructures et au design, et d’autre part étant donné l’espace dans lequel l’individu se trouve, le savoir‑faire de cet individu, ses schémas d’interprétation, les choix effectués par les concepteurs des outils qu’il utilise, les lois en vigueur et les stratégies économiques par lesquelles l’individu est concerné. Des négociations sont possibles, ainsi que des détours, des réappropriations, des fuites, des subjectivations. Tous les acteurs n’ont certes pas la même capacité d’exercer un « pouvoir faire » et un « pouvoir de faire faire », mais tous jouissent d’une marge de manœuvre qui, même infime, peut changer le cours des processus qui le concerne.
40Penser les influences mutuelles par le prisme de la « gouvernementalité », c’est chercher à appréhender les projets et les stratégies des gouvernants, pour mieux comprendre la manière dont ils entendent influencer les comportements des gouvernés, et identifier potentiellement les possibilités de s’en affranchir. Le recours à ce concept a pour conséquence de politiser l’analyse de la production des cadres techniques, et n’est pas exempt d’un projet émancipateur, celui du renforcement des capacités d’action des usagers au sein des environnements numériques. A l’heure où l’enseignement du code à l’école fait débat au sein de l’espace public, l’apprentissage du décryptage des incitations, des contraintes et des cadres d’action qui nous sont proposés au sein de ces environnements constitue aujourd’hui un enjeu de citoyenneté.
Bibliographie
Akrich M. (1998), « Les utilisateurs, acteurs de l’innovation », Éducation permanente, 134, p. 79-89
Bachimont B. (2010), Le sens de la technique : le numérique et le calcul, Paris, Les belles lettres, coll. « encre marine », 190 p.
Badouard R. (2012), Les « technologies politiques » du web. Une étude des plateformes participatives de la Commission Européenne et de leurs publics, Thèse en Sciences de l’Information et de la Communication, UTC Compiègne, 536 p.
Badouard R. (2014), « La mise en technologie des projets politiques. Une approche « orientée design » de la participation en ligne », Participations, 2014/1, p.31-54.
Benabou R., Tirole J. (2003), « Intrinsic and Extrinsic Motivation », Review of economic studies, 70, p. 489-520.
Benkler Y. (2016), « Degrees of freedom, dimensions of power », Daedelus, Vol. 145, No. 1, Pages 18-32.
Brin S., Page L. (1998), « The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine », Computer Science Department, Stanford University, disponible ici : http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html
Cardon D. (2015), A quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l’heure du big data, Le Seuil.
Cardon D. (2013), « Dans l’esprit du PageRank. Une enquête sur l’algorithme de Google », Réseaux, 1, n°177, p. 63-95.
Cardon D., Jeanne-Perrier V., Le Cam F., Pélissier N. (2006), « Autopublications. Présentation du numéro », Réseaux, n°137, p. 9-25.
Cohen Y. (2011), « Foucault déplace les sciences sociales. La gouvernementalité et l’histoire du XXe siècle », in P. Laborier et al., Les sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, p. 43-79.
De Certeau M. (1980), L’invention du quotidien, 1. arts de faire, Paris, UGE/10-18, 348 p.
Flichy P. (2003), L’innovation technique. Récents développements en sciences sociales. Vers une nouvelle théorie de l’innovation, Paris, La Découverte, coll. « Sciences et société », 256 p.
Foucault M. (1975/1993), Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 360 p.
Foucault M. (1994), Dits et écrits (vol. 1, 2 et 3), Paris, Gallimard, coll. « Quarto ».
Foucault, M. (2004) Sécurité, territoire, population. Cours au collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard-Seuil.
Fuller M. (dir.), 2008, Software Studies. A Lexicon, Cambridge, Leonardo Book Series.
Jeanne-Perrier V. (2005), L'écrit sous contrainte : les Systèmes de management de contenu (CMS). In: Communication et langages. N°146, 4ème trimestre 2005. p. 71-81.
Jouët J. (2000), « Retour critique sur la sociologie des usages », Réseaux, 100, p. 487-521.
Laffont J.-J. (2006), « À propos de l'émergence de la théorie des incitations », Revue française de gestion, 2006/1 no 160, p. 177-189.
Latour B. (1999), Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge MA / London, Havard University Press, 336 p.
Latour B. (2007), Changer la société, refaire de la sociologie (première version publiée en anglais en 2005), Paris, La Découverte, 400 p.
Latour B., Mauguin P., Teil G. (1991), « Une méthode nouvelle de suivi des innovations : le graphe socio-technique », in : Vinck D. (dir.), La Gestion de la recherche. Nouveaux problèmes, nouveaux outils, Bruxelles, De Boeck, p. 419-567.
Luhmann Niklas, Suhrhampf Verlang, Ackermann Werner, Quéré Louis. Communication et action. In: Réseaux, 1991, volume 9 n°50. pp. 131-156.
Quiers-Valette S. (1978), Un nouveau concept de politique économique: l'incitation, Hachette, L'économie et le social.
Mabi C. (2014), Le débat public à l’épreuve du numérique. Entre espoirs d’inclusion et contournements de la critique sociale, Thèse en Sciences de l’Information et de la Communication, UTC Compiègne.
Manovitch L, 2013, Sotware Takes Command, New York, Bloomssbury Academic.
Monnoyer-Smith L. (2010), Communication et délibération. Enjeux technologiques et mutations citoyennes, Paris : Hermès Lavoisier, 2010.
Moulier-Boutang Y., (2007) Le capitalisme cognitif. La grande transformation, Paris, Amsterdam.
Rieder B. (2006) Métatechnologies et délégation. Pour un design orienté-société dans l’ère du Web 2.0, Thèse en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis, 388 p.
Rieder B. (2012), « What is in PageRank? A Historical and Conceptual Investigation of a Recursive Status Index », Computational Culture.
Röhle T. (2009), « Dissecting the Gatekeepers. Relational Perspectives on the Power of Search Engines », in : Becker K, Felix S. (dir.) Deep Search. The Politics of Search beyond Google, Innsbruck, StudienVerlag, p. 117-132.
Rouvroy A., Berns T., (2013), « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux, n°177, p.163-196.
Rushkoff D., Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age, Soft Skull Press, 2011.
Simondon G. (1958), Du Mode d’existence des objets techniques, Paris : Editions Aubier (ré-édition de 1989).
Sire G. (2015), Google, la presse et les journalistes. Analyse interdisciplinaire d’une situation de coopétition, Bruxelles, Institut du Droit de la Concurrence / Bruylant, coll. « Sciences Politiques », 426 p.
Sire G. (2016), « Le pouvoir normatif de Google. Analyse de l’influence du moteur sur les pratiques des éditeurs », Communication & Langage, à paraître.
Souchier E., Jeanneret Y., Le Marec J. (2003), Lire, écrire, récrire : Objets, signes et pratiques des médias informatisés, Bibliothèque Publique d’information.
Thierry B. (2013), Donner à voir, permettre d’agir. L’invention de l’interactivité graphique et du concept d’utilisateur en informatique et en télécommunications en France (1961-1990), Thèse d’histoire contemporaine, Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
Tirole J. (2009), « Motivation intrinsèque, incitations et normes sociales », Revue économique 3/ 2009 (Vol. 60), p. 577-589.
Woolgar S. (1991), « The turn to technology in social studies of science », Science, Technology and Human Values, vol.1, n°16, p.20-50.
Wright S., Street J. (2007), « Democracy, deliberation and design : the case of online discussion forums », New Media Society, n°9, vol.5, p.849-870.
Zittrain J. (2009), The Future of the Internet : And How to Stop It, Penguin.
Notes
1 Voir également (Foucault, 1975).
2 Cet article a bénéficié des retours de plusieurs chercheurs qui ont contribué à son amélioration, et que les auteurs souhaiteraient remercier ici. Ce papier a ainsi fait l’objet d’une discussion dans le cadre du séminaire DEL, dans lequel il a pu bénéficier des retours de Guillaume Gourgues et Fabien Granjon. Sylvain Parasie ainsi que les membre du Centre d'Analyse et de Recherche Interdisciplinaire Sur les Médias (CARISM) nous ont par ailleurs fait l’amitié de commenter et critiquer une version antérieure de cet article.
3 Voir par exemple les travaux de Antoinette Rouvroy et Thomas Berns sur la gouvernementalité algorithmique (2013).
4 http://googlewebmastercentral.blogspot.fr/2008/10/linking-out-often-its-just-applying.html
5 https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=fr#3
6 Les effets des outils numériques sur nos pratiques d’écriture sont bien documentés en sciences de l’information et de la communication, notamment à travers la mobilisation du concept d’ « architexte » (Souchier, Jeanneret, Le Marec, 2003) qui décrit la manière dont ces outils appliquent des formats aux pratiques d’écriture par une configuration des possibles, inscrite dans le design même des logiciels.
7 Voir le dossier « Web is dead » de la revue Wired consultable à l’adresse suivante : http://www.wired.com/2010/08/ff_webrip/
Pour citer ce document

Ce(tte) uvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
